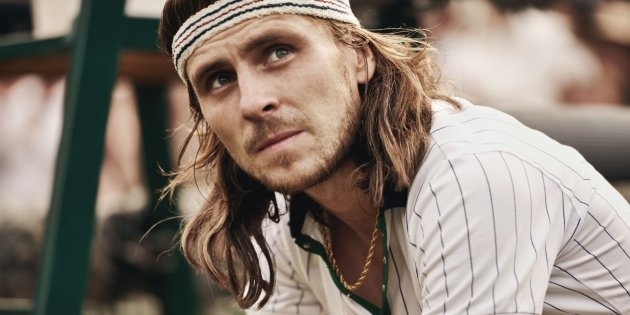John Huston
Thelma (Joachim Trier)

Oslo, 31 août (2011) et son personnage suicidaire inspiré du Feu follet de Drieu La Rochelle m’avait secoué, comme beaucoup. Les critiques très mitigées m’ont détourné du film suivant, Back home, à tort peut-être. A propos du norvégien Joachim Trier reviennent souvent les mêmes reproches. Ses scénarios sont sur-écrits et sa mise en scène penche vers une sophistication trop voyante. Ce sont des critiques qui peuvent être faites à Thelma. Néanmoins, à l’image de cette vaste couche de glace qui éblouit le premier plan du film, on saura gré au réalisateur d’aller regarder les choses inquiétantes qui se cachent derrière une surface lisse et brillante. Trier est citoyen d’un pays parmi les plus prospères et confortables du monde, la Norvège et il parvient très bien à montrer le malaise derrière la normalité apparente.