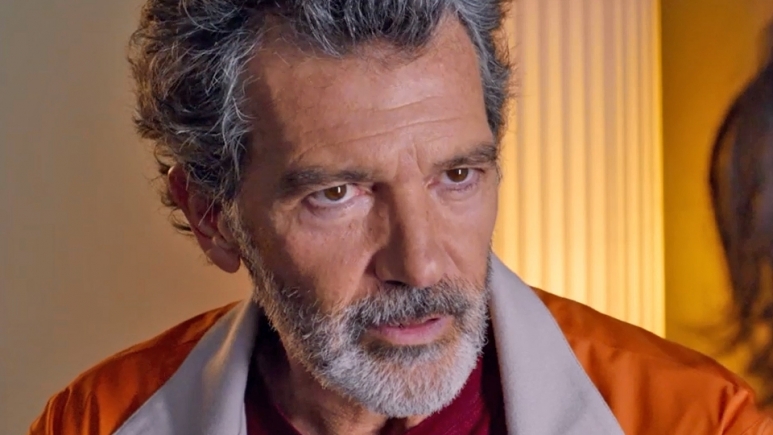John Huston
Le daim (Quentin Dupieux)

Dans Dillinger est mort de Marco Ferreri, la découverte d’un pistolet emballé dans un journal finit par donner des envies de meurtre au personnage de cadre supérieur joué par Michel Piccoli. Dans Breakup – érotisme et ballons rouges (quel titre !), c’est un industriel joué par Marcello Mastroianni qui obsédé par le gonflement de ballons de baudruche perd la tête et se suicide. Il faut redécouvrir l’œuvre de Ferreri après celle de Buñuel. Derrière la façade de normalité se cachent la folie, l’aliénation et la barbarie. Quentin Dupieux, qui n’a pas inventé l’absurde au cinéma, serait un héritier de ce cinéma-là tant son œuvre travaille l’obsession et les situations absurdes. Il l’a dit en interview à Libération : « En fait, Buñuel est tellement fondamental que je trouverais anormal de ne pas passer par lui. » A la vision du Daim et aux souvenirs de Rubber et de Réalité, on devine aussi une forme de discours et d’auto-analyse sur sa propre condition de créateur dans le cinéma.