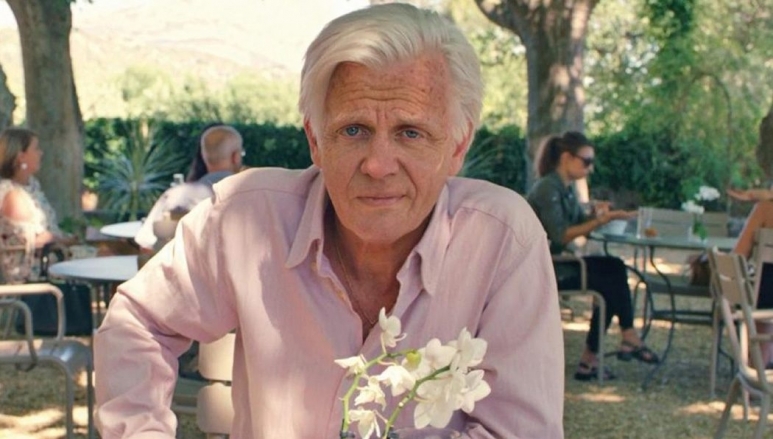John Huston
La favorite (Yorgos Lanthimos)

On sort de ce film à costumes et on regarde les notices historiques sur Anne Stuart, reine d’Angleterre de 1702 à 1714. Anne Stuart était une reine pieuse, anglicane convaincue. Les rumeurs de liaison lesbienne avec sa favorite Abigail Masham proviendraient du portrait très négatif que la Duchesse de Marlborough, jalouse d’être évincée, aurait fait de la souveraine. Les historiens modernes décrivent une reine différente de celle décrite dans le film, sérieusement impliquée dans les affaires de son pays. Toutefois, le fait qu’elle ait été malade une grande partie de sa vie et rendue presque obèse par dix-sept accouchements a pu corroborer l’idée sexiste d’une femme sous influence. C’est cette orientation que Lanthimos a privilégiée, prêtant le flanc aux accusations de misogynie tout en développant sa vision très pessimiste de l’humanité.