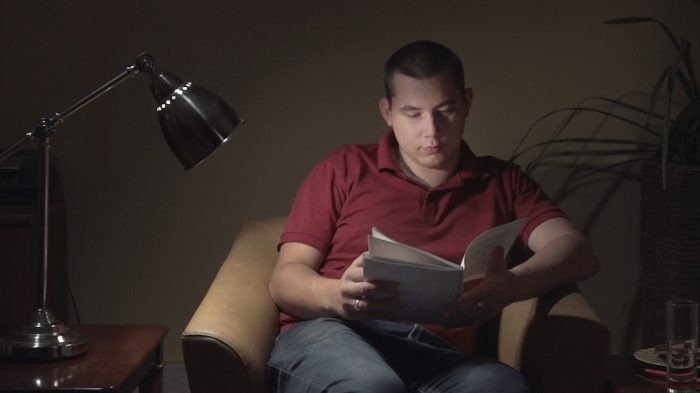John Huston
Sympathie pour le diable (Guillaume de Fontenay)

Avant le film du même-nom, Sympathie pour le diable est le titre de l’ouvrage autobiographique que le reporter Paul Marchand a consacré en 1997 à son expérience de la guerre en ex-Yougoslavie. Le journaliste a séjourné et travaillé à Sarajevo, pendant le siège de la ville par les forces serbes. Bien que Marchand ait été une voix fréquente sur France Inter, RFI, France Info etc. je découvre comme beaucoup l’existence de cet homme. Grâce à Niels Schneider, un acteur dont j’apprécie de plus en plus le travail, j’imagine certains traits de caractère, forcément présents dans le livre : l’intrépidité, l’indépendance d’esprit, le courage, l’esprit critique. La figure du reporter est en soi tellement romanesque qu’elle a nourri de multiples films, plus ou moins intéressants (Salvador d’Oliver Stone, L’année de tous les dangers de Peter Weir, La déchirure de Roland Joffé…). Parmi cette longue liste de films, Sympathie pour le diable est-il recommandable ?