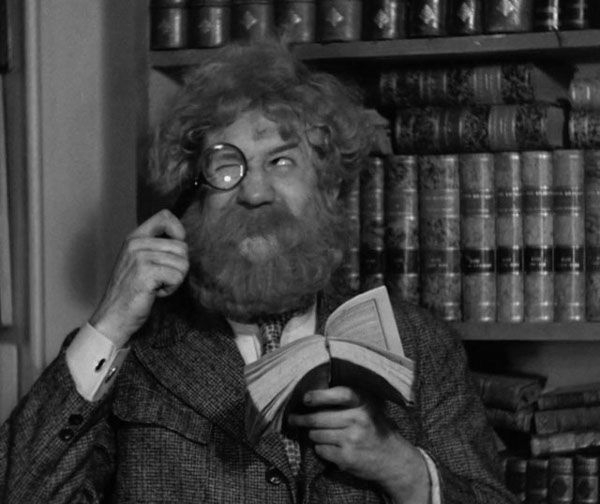Le premier plan est flou. Des hommes creusent un trou. Il y a une rumeur qui s’amplifie et des gens courent. Saul entre précipitamment dans l’image et n’en sortira plus. Le film nous jette brutalement dans l’enfer d’Auschwitz-Birkenau en nous collant à la peau de Saul Auslander, un juif hongrois faisant partie des sonderkommandos, groupe d’hommes valides qui mènent les déportés aux chambres à gaz puis se débarrassent des cadavres. La première impression qui m’a saisi est la sensation de voir en Saul, avec sa démarche raide et mécanique, son teint terreux, un personnage de jeu vidéo, comme guidé par une manette (celle du réalisateur), allant à gauche, à droite, un peu partout. Impression très étrange de suivre un corps mais à peine un homme tant Saul balloté est réduit à peu de paroles, à peu d’affects, renforcé en cela par le jeu impénétrable de Gheza Rohrig.
Flux de circulations chaotiques
Le fils de Saul se distingue du tout-venant par sa mise en scène fluide, élaborée à coups de steadicam. Les corps qu’on devine ou aperçoit furtivement sont des « pièces », des « paquets » qui circulent, triés et entreposés comme des marchandises. S’il est une chose que Lazlo Nemes a réussi à nous faire voir par son travail, c’est la réification des humains dans l’univers concentrationnaire. Le film se joue comme un mouvement, un flux ininterrompu de circulations chaotiques. C’est un maelstrom – définition commune : un puissant tourbillon – qui emporte les corps hors champ et le corps de Saul qui est balloté d’une tache à l’autre. L’effet d’emportement est décuplé par le travail sur le son, fait de strates cauchemardesques empilant les cris des gardes nazis, ceux des kapos, les gémissements des victimes, les bruits de la machine de mort (grondements, pistons), les coups de feu. L’effet est saisissant car les cris des bourreaux sont permanents tout en jouant le rôle de décharges électriques qui font mouvoir les corps brusquement. Les procédés du réalisateur aboutissent à un effet voulu d’oppression et de chaos. En cela, le film semble assez juste sur ce qu’est un camp d’extermination : certainement pas un lieu ordonné où la mort est opérée glacialement et rationnellement mais un lieu chaotique où l’arbitraire est roi. Saul est vivant mais en plein d’occasions il pourrait mourir, sa survie ne tient qu’à une suite de chances.
Un véhicule
L’aspect immersif de la réalisation ne se suffit pas à lui-même et se retourne même contre le film. Celui qui nous guide, Saul, nous avons beau lui coller aux basques, nous ne le connaissons pas et le scénario ne nous donne pas de quoi nous rattacher émotionnellement à lui. Saul n’est pas un personnage mais un véhicule. Véhicule de la caméra dans l'enfer d’Auschwitz. Véhicule d’une idée : qu’on peut rester humain dans un univers inhumain. Dans la chambre à gaz, Saul pense reconnaître son fils. De là, il cherche à protéger le corps et à lui donner une sépulture comme le veut la tradition juive. Pourquoi s’entête-t-il à cela alors qu’à côté de lui les autres membres des kommandos cherchent à survivre et à résister par les armes ? De même, l’épisode où il rejoint Ella dans le camps réservé aux femmes ne dit rien de lui. Quelque chose ne fonctionne pas dans l’articulation entre la mise en scène du chaos d’Auschwitz et le personnage fantomatique de Saul : l’aspect fictionnel du film. J’avais été saisi de la même déception en lisant il y a quelques années Primo Levi (Si c’est un homme) et je comprends pourquoi : j’attendais un intérêt romanesque de son récit, alors que la description de l’univers concentrationnaire, sec et déshumanisé, se dérobe à cette attente. C’est une expérience indescriptible et le film de Nemes en est peut-être le constat. Il tente de raconter une histoire tout en se retenant constamment de le faire. Faire une fiction sur Auschwitz et y mettre des artifices émotionnels, c’est risquer le mensonge. Nemes n’a pas osé franchir le pas et creuser la veine fictionnelle. Son film est donc un intense exercice de mise en scène qui oppresse le spectateur mais ne peut pas le bouleverser.
Cela donne raison à Claude Lanzmann qui a adoubé le film mais peut-être pas pour les raisons qu’on croit. Malgré sa mise en scène puissante et élaborée, Le fils de Saul démontre la difficulté voire l’impasse d’une fiction cinématographique sur Auschwitz. Il semble faire la preuve que seul le documentaire peut approcher la vérité sur l’expérience concentrationnaire. Le seul moyen honnête d’atteindre l’émotion et l'identification du spectateur est de faire témoigner les survivants et les lieux, comme dans Shoah. Le spectateur sera bouleversé par la mémoire qui surgit.